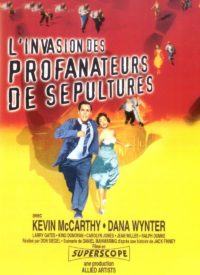The Addiction
Bloody Sin City
En 1996, The Addiction s’inscrit dans une période prolifique pour Abel Ferrara, une sorte d’âge d’or où le réalisateur enchaîne les projets et sort un film par an depuis 1990. Cette œuvre en noir et blanc succède à The King of New York, Bad Lieutenant, Body Snatchers et Snake Eyes. En France, cette année-là sortira même un deuxième (et grand) Ferrara, Nos Funérailles. Pour The Addiction, il s’attaque au thème du vampire, se prive volontairement de couleurs, celle du sang notamment, pour réaliser une œuvre graphique très bavarde, jouant sur de nombreux tableaux. Il s’amuse avec certains codes traditionnels du mythe qu’il place dans sa ville de prédilection, New York, pour en faire une œuvre gothique contemporaine. Si la métaphore avec le sida est explicite, Ferrara s’en écarte aussitôt pour traiter la maladie qui ronge le personnage principal de façon autrement plus nuancée et lui donne l’occasion d’aborder des questionnements qui vont au-delà du bien, du mal, du péché, de la religion, de la culpabilité…
Ferrara et son scénariste Nicholas St. John trouvent dans ce matériau une opportunité de parler de la condition humaine de manière universelle, à grands coups de références, de citations philosophiques et au travers de dialogues très nourris entre les protagonistes; et ainsi tenter de proposer des réponses aux contradictions propres à l’Homme, cet être capable à la fois de créer des œuvres de toute beauté tout comme d’une violence absolue. Création, dépendance, autodestruction, mais aussi contrôle de soi sont au menu de The Addiction, à l’image de Ferrara lui-même, toujours à la table des vivants qui aiment braver la mort.
Morsure subite
Le film démarre par des plans fixes, diapositives diffusées sur un écran lors d’un cours à la faculté. Des images du Vietnam, de soldats américains en action, de populations en souffrance, de dirigeants désignés coupables… Entre Kathleen (Lili Taylor) et son amie Jean (Edie Falco), étudiantes en philosophie qui ont assisté à cette projection, une discussion s’ensuit afin de tenter de comprendre comment ces actes terribles ont pu être perpétrés par certains hommes. Inexplicables sans analyse ni recul. La raison et l’entendement sont questionnés. Plus tard dans le métrage, des images de camps nazis apparaîtront à leur tour, diluant un peu plus des exemples d’horreurs humaines pas si lointaines. Kathleen, sérieuse et plutôt craintive lorsqu’elle se promène dans les rues de New-York, est abordée un soir par une élégante femme. Celle-ci la mène de force dans un recoin et l’intime de lui demander de s’en aller. La jeune fille en est incapable et son “please” la condamne plus qu’il ne la protège. Elle est mordue dans le cou par cette inconnue qui s’en ira aussi soudainement qu’elle est apparue. Un moment traumatisant pour Kathleen, un acte incompréhensible pour lequel elle ne trouve de réponse.
Kathleen va passer par une première phase de mal-être, de souffrance physique et va peu à peu observer le monde qui l’entoure avec un nouveau regard, contemplant ses semblables de manière de plus en plus détachée. Guidée par des pulsions nouvelles, elle perd le sommeil et l’appétit, errant dans les rues en pleine nuit. Elle développe une première attirance pour le sang et, à l’aide d’une seringue, en extrait un peu du bras d’un sans-abri pour se l’injecter. Telle une droguée, elle ressent vite un manque dont elle ignore d’abord la source, mais sa nouvelle nature va la guider naturellement vers la jugulaire de proies malheureuses. Elle se désinhibe peu à peu, quittant sa fragilité antérieure et le confort de son milieu d’origine, attirée par la découverte de l’inconnu, que ce soit en termes d’expériences, de cultures nouvelles ou de rencontres qui l’effrayaient auparavant.
Horreurs humaines
En livrant régulièrement des extraits d’archives dans son film, Ferrara consolide son choix du noir et blanc, inscrivant son histoire dans le prolongement de l’Histoire, sans recherche de distinction visuelle, pour atteindre une unité qui frôle l’évidence. The Addiction devient un film d’horreurs au pluriel et rend le vampirisme presque acceptable. Les actes cruels de la créature nocturne, guidée par son instinct, s’apparentent à ceux d’un prédateur avec sa proie, et sont en réalité bien moins condamnables que le comportement de certains hommes détruisant des vies pour le pouvoir ou la conquête. Sa rencontre fugace avec Peina (Christopher Walken, acteur instinctif par essence, habitué de Ferrara), lui-même vampire depuis bien longtemps, va remettre en cause la place de Kathleen dans ce nouveau monde qui s’ouvre à elle, voire même sa place dans la chaîne alimentaire. L’invitant chez lui, dans son appartement transpirant l’amour des arts (la peinture, la sculpture, la littérature, la musique, l’architecture), ce dandy élégant va lui faire découvrir une nouvelle sensation: le manque, lié à cette addiction toute récente. Ferrara aurait pu incarner lui-même le personnage de Peina, alter ego bien conscient de sa condition qui le rend esclave d’un monde dont il se nourrit et qui lui dicte ses actes. Mais son personnage, Peina, tellement éclairé et lucide, est parvenu avec le temps à maîtriser cette dépendance, au point de se sentir redevenir presque humain. Ou un semblant d’humain. Dans son enveloppe de chair, la philosophie, le bouddhisme, lui servent à maîtriser ses pulsions, à dompter des besoins primaires comme la faim ou la soif de sang.
Qui a dit Vampire ?
Le terme vampire n’est en réalité ni évoqué ni prononcé, la quête de victimes n’est pas qu’une quête de sang. Elle s’apparente à une soif de connaissances, de besoin de compréhension du monde qui nous entoure. Ferrara s’empare du sujet de manière intellectuelle, pompeuse diront certains. En réalité, il considère simplement ses spectateurs comme ses semblables, des êtres intelligents, avides de connaissances eux aussi, à qui il est inutile de rappeler les préceptes du mythe du vampire et friands des concepts philosophiques qu’on leur sert. Lui-même animal nocturne, réalisateur rock’n’roll aux addictions multiples, il aborde donc le genre comme il l’a fait avec le polar ou le film de vengeance: à sa manière. The Addiction s’imprègne de hip-hop autant que de philosophie et de spiritualité, et reflète le plaisir de livrer une œuvre entière, collective, sans compromis.
Les noirs profonds envahissent le cadre par la chevelure dense de Lili Taylor.Ses vêtements et le sang font ressortir sa peau blafarde. La nuit et le jour se confondent souvent grâce à des clairs obscurs du plus bel effet. Ferrara décrit le monde comme un grand cimetière, un monde déjà mort, ou mort d’avance, dans lequel ces êtres érudits et nocturnes ne font que se servir, se dévorer mutuellement. Kathleen se nourrit intellectuellement, comme si elle absorbait toute l’essence de sa victime et intégrait tout ce qu’elle a accumulé comme savoirs.
Philosophie du vampire
Ferrara nous entraîne, sans que l’on s’en rende compte clairement dans les tréfonds de notre propre âme, notre âme à tous, qui contient de manière commune un pouvoir de création sublime tout comme cette capacité de nuire, de générer des atrocités au-delà de l’entendement. Le bien et le mal sont en chacun de nous, l’un comme l’autre ayant son pouvoir d’attraction indéniable. Une addiction à l’un ou à l’autre peut ainsi nous faire basculer sans prévenir, susciter un appétit au point de dénaturer l’être que nous sommes.
Et donner envie de fuir cette condition humaine, gangrenée par l’habitude, frustrée par la peur et la fatalité. Trop conscients de faire partie d’un monde s’auto-dévorant jusqu’à l’écœurement, qui s’auto-cite pour mieux s’en convaincre. A travers Peina, Ferrara cite William Burroughs, célèbre représentant d’une contre-culture et sujet à de nombreuses addictions, s’affirmant comme un descendant d’une lignée de figures hors normes.
Et on le comprend. Tout comme l’auteur du Festin Nu, il a goûté l’interdit, refusé le manichéisme ou le noir et blanc sans nuances. Ferrara révèle les zones d’ombres mieux que personne. Pour lui, tous les hommes, qu’ils soient auteurs, artistes, philosophes, clochards… sont des vampires finalement, s’inspirant de leurs prédécesseurs.
Mais Ferrara reste très humaniste dans son propos et même s’il utilise la violence pour exprimer ses pensées profondes, il nous fait part de sa vision d’un monde idéal, une société où tous les êtres sans exception seraient rassemblés (intellectuels, hommes et femmes de toutes les couleurs, de tous milieux, de tous âges, hip hop et classique, drogués et saints…). Son orgie finale ultra sanglante assoit de confirmer que c’est en se nourrissant les uns des autres, du passé comme du présent, que l’on finit par être égaux. Cette morsure qui semblait d’abord condamner la victime à une malédiction apparaît à la fin comme une bénédiction, une soif de transmettre aux autres encore et encore, comme une part d’éternité qu’on offrirait. The Addiction traverse le temps sans prendre une ride, toujours ultra moderne de par sa mise en scène gracieuse et l’énergie que Ferrara et son équipe ont su lui insuffler. Vampirisant pour longtemps.