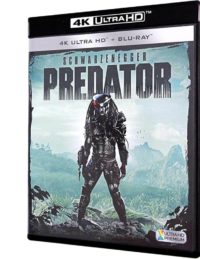Predator I
Partie de chasse
Est-il encore utile de présenter Predator plus de trente ans après son arrivée sur la planète cinéma ? Ce film d’action a débarqué dans la glorieuse décennie qui a vu se réinventer bon nombre de genres cinématographiques, engendré de nouveaux héros plus iconiques les uns que les autres, développé des concepts et des imaginaires toujours aussi marquants. Si aujourd’hui le revival eighties sacralise absolument tout de cette époque, du jeu vidéo à la musique, et même la mode vestimentaire que beaucoup avaient alors honte de porter, il est bon de replacer certaines œuvres dans leur contexte. Car la qualité d’un film, et surtout la manière dont il traversera le temps, tiennent parfois à peu de choses. Schwarzenegger, en pleine ascension depuis Conan et Terminator, enchaîne depuis 1984 un voire deux films par an. Il est une valeur sûre pour les studios, et le public est toujours au rendez-vous. Même si ses choix ne sont pas toujours de grandes réussites artistiques, ses meilleures performances en tant que comédien sont souvent liées à la personnalité de ses réalisateurs, à la capacité de ceux-ci à diriger le chêne autrichien. Predator, tombé entre de mauvaises mains, serait sûrement devenu un film quelconque, un Alien du pauvre. C’est Arnold lui-même qui va être en grande partie le coupable inspiré de la réussite du film, en suggérant John McTiernan au poste de réalisateur. Cet inconnu de 36 ans, qui a à son actif un unique film passé relativement inaperçu, va non seulement transformer cette histoire assez banale en un survival dantesque, mais aussi et surtout initier rien de moins que le futur du cinéma d’action des années 90…
Un film en « or »
Lorsque Predator est annoncé au cinéma en 1987, le titre peut prêter à sourire, notamment en France. La décennie 1980 a vu fleurir les Terminator, Exterminator, Kalidor, Ninja Terminator, Re-animator, American Warrior… des titres qui, pour certains bien pensants de la culture, sont synonymes d’œuvres à remiser immédiatement au placard. D’ailleurs, un grand nombre de journaux spécialisés n’y sont pas allés de main morte pour qualifier Predator de film sans originalité, décérébré, de grosse machine sans âme, d’un énième film d’action à la Rambo. A croire que certains l’ont simplement ignoré ou critiqué sans même l’avoir vu. Si aujourd’hui Predator est bel et bien considéré comme un classique, les fans de la première heure sont à chercher du côté des fantasticophiles, des amoureux de monstres et des effets spéciaux. Mais également dans l’expérience la plus pure qui puisse être, celle d’un adolescent qui, du haut de ses treize ans (et demi), dénué d’a priori, de culture cinématographique très étendue, vierge de toute bande-annonce, découvre dans une salle de cinéma de village aujourd’hui disparue “le dernier Schwarzenegger”. La simple affiche dévoilant la musculature impressionnante de la mégastar armée sur un fond végétalisé avait alors suffi à attiser sa curiosité de spectateur en quête d’action pure et simple. En pensant aller voir naïvement un film “avec des soldats” à la croisée de Rambo et de Commando, le jeune garçon était loin de se douter qu’il allait se retrouver face à tout à fait autre chose. La découverte en salle de Predator ne sera ni plus ni moins que la genèse, le détonateur pourrait-on même dire, de sa cinéphilie…
A Gordon-Silver-Davis production
D’abord producteur associé de films tels que Les Guerriers de la Nuit, 48 heures, Les Rues de feu pour le compte de la Lawrence Gordon Pictures, Joel Silver fonde Silver Pictures en 1985 et va marquer au fer rouge le cinéma d’action à venir. Commando et L’Arme fatale d’abord, puis Predator et sa suite, la série des Die Hard, les Matrix… autant de succès qui portent indéniablement son empreinte : des choix audacieux de réalisateurs, d’acteurs charismatiques (et souvent musclés) et de projets pas toujours gagnés d’avance sur le papier. Pour preuve, Predator, dont le scénario titré The Hunter est le premier des frères Thomas, démarre comme une blague : ils écrivent cette histoire en réponse à la Rockymania ambiante, dont le quatrième opus du boxeur fut un succès tel qu’Hollywood clama que le prochain adversaire du boxeur ne pouvait être qu’un extraterrestre. Cette première collaboration de Silver avec John McTiernan tient du miracle: son précédent film Nomads, loin d’être un succès public, ne passe pas totalement inaperçu et par chance, Arnold l’a vu et y décèle un potentiel. Une première œuvre certes déséquilibrée, à la croisée de plusieurs genres, qui reste néanmoins hypnotique, dans une ambiance urbaine nocturne qui lorgne du côté de Michael Mann. De la jungle de Los Angeles à la forêt tropicale, il n’y a qu’un pas…
McTiernan l’anthropologue
Il est d’ailleurs intéressant de constater que les deux films contiennent des thématiques assez proches. Tandis que Nomads est un scénario original écrit par McTiernan, dont le personnage principal est un anthropologue d’origine française (joué par Pierce Brosnan), on décèle dans les deux métrages un intérêt certain pour l’étude des comportements humains et le langage, la fascination pour les individus marginaux et leur rapport au danger (qui se confirmera dans toute sa filmographie). Dans Nomads, l’ennemi, sans cesse en mouvement, est invisible à sa manière et fonctionne avec des codes qui lui sont propres. Dans Predator, McTiernan va lui-même se placer comme un observateur et parviendra comme c’est rarement le cas dans cette catégorie de films à donner de la consistance à l’ensemble de ses personnages et à les rendre d’autant plus attachants. Ce n’est pas le genre qui l’intéresse, mais les gens et leurs interactions sociales, leurs oppositions nombreuses. Qu’il s’agisse de Predator ou de Die Hard, le matériau scénaristique initial est loin de le subjuguer. C’est bien par ses apports personnels, un recul évident par rapport à l’industrie et sa vision bien à lui qu’il parviendra à sublimer la plupart de ses œuvres.
Un tournage mémorable
Avril 1986 au Mexique. Le tournage de Predator démarre en pleine jungle et devient rapidement une épreuve pour toute l’équipe de gros bras. Un certain Jean-Claude Van Damme, originaire de Belgique, cascadeur sur Portés Disparus, endosse le costume durant quelques jours d’une créature assez ridicule à ce stade-là de la production. La star d’action belge en devenir, plutôt lucide quant au désastre potentiel, quitte le tournage, refusant de se risquer à des cascades bien trop dangereuses à ses yeux. Silver et McTiernan se rendent compte un peu tardivement du choix désastreux de concept qu’ils avaient effectué et confié à Steve Johnson. Celui-ci les avait pourtant bien mis en garde de l’impossibilité de faire fonctionner une créature aussi complexe, surtout dans un décor naturel si hostile. Le design est abandonné, et Johnson se voit remplacé par Stan Winston, le génial créateur du Terminator et de la Reine Xénomorphe d’Aliens. Là encore sur les conseils avisés d’Arnold. Un coup de maître, son Predator s’inscrivant immédiatement au panthéon des plus beaux monstres que le cinéma ait engendrés. Le tournage, retardé pendant plusieurs semaines, peut reprendre en novembre dans des conditions plutôt rudes : les journées chaudes et humides laissent la place à des nuits particulièrement fraîches. Blessures diverses chez les acteurs et les cascadeurs, puis la tourista qui se charge d’affaiblir même les plus coriaces de l’équipe. Arnold le premier, qui sera hospitalisé et perdra dix kilos ! Abus de cuisine et de boissons locales? Malgré de douloureux souvenirs, il va de soi que cette nature, certes peu commode, a sans aucun doute inspiré et impliqué l’équipe technique dans son entièreté, bien plus que des prises de vue en studio ne l’auraient permis. Le résultat à l’écran transpire l’authenticité, tant du côté des acteurs, en totale osmose avec cet environnement, que de celui des effets spéciaux, dont la simplicité apparente (effets thermiques et de camouflage) est le résultat d’une grande habileté et d’une volonté de cohérence avec son propos. La mise en scène de McTiernan en fera l’expérience immersive et le modèle de modernité que l’on sait.
Escape from Val Verde
Et pourtant, le début du film n’augure rien d’exceptionnel. Si on met de côté sa discrète scène d’introduction, où un vaisseau largue depuis l’espace une capsule en direction de la Terre, Predator commence comme un film d’action classique, dans la droite lignée d’un Rambo II ou de Portés Disparus. La virilité inonde de sueur l’écran, depuis l’arrivée par hélicoptère des mercenaires aux retrouvailles de Dutch (Arnold Schwarzenegger) et Dillon (Carl « Apollo Creed » Weathers), tellement bigger than life: vingt secondes d’un bras de fer légendaire en guise de salutations, surlignées par des répliques et les sourires ravageurs des deux action-stars quadragénaires au sommet de leur forme. Le ton est donné, il n’y aura que peu de place accordée à la poésie et à la subtilité. La mission « simplissime » ayant été clairement énoncée, à savoir aller délivrer le temps d’une journée un Ministre et son assistant rescapés d’un crash au Val Verde, l’escouade peut partir affronter la guérilla locale qui détient assurément les otages. C’est l’occasion de faire connaissance avec chacun des membres de l’équipe, belle compilation d’archétypes de mâles dominants, à la limite de la caricature, aux traits épais mais si bien dessinés ! Alors que Long tall Sally de Little Richard couvre à peine le doux bruit des pales des hélicoptères, nous faisons la connaissance de chacun des protagonistes : Mac (Bill Duke) qui use de son rasoir sur son visage vierge de tout poil, Blain (Jesse Ventura) lequel chique son tabac à pleines bouchées laissant apparaître un sourire de satisfaction derrière ses belles moustaches, Billy (Sonny Landham) quant à lui étale sur son visage des peintures de guerre tel un indien, Hawkins (Shane Black) qui sort ses blagues graveleuses sans rencontrer de succès auprès de ses compagnons, et enfin Poncho (Richard Chaves) qui incarne le nerveux de l’équipe. Des “tronches” immédiatement identifiables qu’il ne reste plus qu’à développer le moment venu…
Welcome to the Jungle
Changement de décor et d’ambiance. Le machisme outrancier cède la place à la quiétude végétale et brumeuse de la jungle du Val Verde (un pays fictif, inventé par le scénariste Steven E. de Souza pour les besoins de Commando). Des rythmes sourds de djembé d’Alan Silvestri se font entendre ça et là, comme pour briser le silence pesant. Les soldats parviennent rapidement à découvrir l’hélicoptère accidenté. La forêt envahit l’écran et devient inquiétante lorsqu’elle dévoile derrière les feuillages des cadavres dépecés ou des traces récentes de combats incompréhensibles. La mission n’est pas aussi aisée que prévue et semble réserver de bien mauvaises surprises. Des scènes d’horreur à mille lieux de la mission qui leur a été confiée. Le doute et même la peur commencent à se lire sur les visages des sept hommes, des émotions que ces forces de la nature ne sont pas coutumières de ressentir. Des plans furtifs commencent à s’inviter dans le montage, des visions infrarouges subjectives où les silhouettes des protagonistes s’animent telle une peinture abstraite mouvante, comme des spectres de couleurs chaudes dans un océan bleuté. Dans cet environnement dense et humide, quelqu’un, ou quelque chose, les observe…
Blockbuster de façade
Les soldats se déplacent dans cet enfer vert avec aisance jusqu’au camp des guérilleros où il s’agit d’agir vite. L’exécution sommaire d’un otage a lieu sous leurs yeux, dans une violence rude face à laquelle la réflexion n’est pas permise. C’est l’occasion d’admirer le professionnalisme de nos héros. Infiltration, tactique, le spectacle explosif que l’on est en droit d’attendre est déjà là. Un spectacle à l’ancienne dirait-on aujourd’hui, avec du travail d’artificiers sans images de synthèse, des cascadeurs réalisant des prouesses impressionnantes. Un ballet pyrotechnique mis en scène de manière magistrale. Un final de grand film d’action offert dans la première demi-heure du film. McTiernan se révèle être un talent à la hauteur de cette démesure. Comme pour se délester du fardeau des obligations qu’impose le film d’action hollywoodien, il fait exploser de façon presque cathartique tout ce qu’il est possible de détruire. Une fois l’opération réussie, Dillon ne cache plus son jeu (ni McTiernan d’ailleurs): il a utilisé Dutch et ses hommes pour son propre intérêt. La confiance a été mise à mal entre ces fortes têtes. Désormais, c’est chacun pour soi.
Alors que le commando, augmenté d’une survivante, s’engage sur le chemin du retour, la musique d’Alan Silvestri se fait plus épique, comme pour signifier que le véritable spectacle commence, que l’action, aussi explosive soit-elle, n’a aucun intérêt dans un film si elle ne sert pas un propos. L’intention réelle de John McTiernan, le vrai film Predator s’était dissimulé jusqu’à présent derrière la végétation abondante, mais à force de maculer de sang les feuilles grasses de ces arbres séculaires, la bête s’est réveillée. Sans crier gare, un autre film s’est esquissé, infiltré par un autre metteur en scène qui orchestre sa propre histoire pour en amplifier son intérêt. La caméra se déplace avec une aisance effrontée au ras du sol comme dans les hautes cimes, à l’instar de cette présence hostile qui continue d’observer ces pauvres créatures insignifiantes. La forêt semblait exercer un pouvoir d’attraction sur la caméra de McTiernan, à travers ces zooms effectués à intervalle régulier. C’est désormais l’âme de ses personnages qu’il veut pénétrer par des plans de plus en plus rapprochés. La psychologie affirme doucement mais sûrement sa place.
Men versus wild
Cherchant à décrypter ce qu’il voit et ce qu’il entend, il ne fait aucun doute que le Predator s’amuse dans un premier temps, tel un chat avec des souris. Dans cette partie de cache-cache, les armes sont comme des jouets et deviennent même leur faiblesse (car visibles à l’infrarouge). Et le terrain de jeu est gigantesque. Nos héros ont compris que c’est d’un chasseur qu’il s’agit, un chasseur venu d’ailleurs. Et malgré leur attirail surpuissant, leur supériorité en nombre, c’est un combat totalement inégal qui s’annonce. Le plus inoffensif de la bande est la première victime et se voit littéralement emporté par la jungle. Le blagueur fou part sans gloire, sans occasion de se défendre. L’ennemi est lâche derrière son camouflage, derrière ses armes impitoyables, derrière ses règles bien personnelles. Telle une métaphore cachée qui sous-entendrait que l’Amérique toute puissante devrait en finir avec cet héroïsme exacerbé, cette créature remet à sa place ce groupe d’humains en les réduisant à leur condition de simple mortel. Un schéma de départ assez identique au groupe de marines d’Aliens, le Retour qui partait vainqueur avant même de rencontrer son ennemi. Cette présence, si proche et pourtant invisible aux yeux des hommes, va agir telle une conscience, une remise en question de chaque individu…
Make USA small again
Mais McTiernan, en plus d’avoir évacué l’aspect final explosif, va éviter les poncifs du genre tels que le triangle amoureux, le traître de service, tous ces codes qui nuisent souvent à la narration et servent plus de remplissage qu’autre chose. Ces êtres humains qu’il filme ont du cœur, de l’esprit et de la force, et de la répartie aussi… Les mots servent à exprimer certains sentiments autant que les armes, et le film contient un grand nombre de répliques d’anthologie et des dialogues aiguisés. L’esprit de John Milius n’est pas loin (scénariste de Conan, Apocalypse Now) dans certains échanges : “Je n’ai pas le temps de saigner”, “Si ça saigne, nous pouvons le tuer”, “Je vais tailler ton nom au couteau dans sa chair”. Et il est amusant d’y entendre en VO, dans un échange entre Dutch et Dillon, “My men are not expendable” (Mes hommes ne sont pas remplaçables). Schwarzenegger fera bien partie de la team de Stallone des années plus tard, de la même manière que ses collègues musclés du cinéma US des années 80-90.
Et McTiernan, dans sa radicalité, va nous rendre témoins impuissants de l’extermination pure et simple du commando. Et lorsque la femme reste seule survivante aux côtés de Dutch, celui-ci lui demande de partir. Non pas parce qu’elle est inutile, mais parce que cette nouvelle “mission” qui s’est invitée, qui a décimé ses hommes un à un, il doit tenter de la poursuivre, à défaut de la réussir. Un sentiment de vengeance mêlé à un sens du devoir naturel militaire. McT va remplacer la domination américaine par sa soumission presque ridicule, tant le Minotaure semble surpuissant face à ce Thésée de pacotille. Pour la première fois depuis le début de la Préhistoire, l’Homme se confronte à un vrai prédateur. Et dans cette configuration inédite, plus que la réflexion, c’est l’instinct primal qui doit reprendre le dessus, un retour à l’état de nature. Dutch, tel l’élu parmi le genre humain, va devoir briser les règles de ce Comte Zaroff venu de l’espace.
Survivor
A mesure que se dévoile à nous le Predator, un guerrier en armure d’un autre temps, Dutch qui a compris les points faibles de son adversaire, devient à son tour le chasseur. Maîtrisant lui aussi l’art du camouflage, tel le Rambo de First Blood, il va ne faire qu’un avec la jungle, devenir invisible à son tour. Tandis que le Predator admire les trophées accumulés, dont parmi eux les magnifiques crânes humains, Dutch le caméléon devient de plus en plus primitif, mi homme-mi animal. Le feu, le bois, l’acier, la poudre, l’arc, la lance, les pièges… tous les savoir-faire ancestraux de la chasse et de la survie, ancrés en l’Homme depuis l’aube des temps, ressurgissent. Les mots sont devenus inutiles, un cri de guerre annonce le choc des titans qui va transformer le film en mythologie. Schwarzenegger, plus barbare que jamais, incarne de tous ses muscles le sauveur de notre monde. Il devient le nouveau maître de ce labyrinthe, posant ses pièges ingénieux. Par-delà l’animosité, c’est une fascination mutuelle qui s’instaure entre deux êtres qui se ressemblent. L’humanoïde se rend compte de sa supériorité technologique et, de honte ou par respect, se sépare de son attirail, tombe le masque afin de jouer enfin à armes égales.
Une créature de rêve…
Si les canons de beauté sont tout à fait subjectifs, la gueule qui se révélait soudain aux yeux de Dutch a unanimement conquis la planète des fantasticophiles par son look inédit : une tête tachetée superbe, au crâne proéminent pourvu d’une sombre crinière de dreadlocks, des yeux inquiétants surplombant une mâchoire dotée de mandibules acérées (une idée de James Cameron glissée à l’oreille de Stan Winston). Du jamais vu, magnifiquement incarné par Kevin Peter Hall (déjà un alien belliqueux dans Terreur Extraterrestre) et animé par plusieurs techniciens pour un résultat au réalisme incroyable. La plus belle espèce extraterrestre depuis Alien! Aussi sauvage et impitoyable que le Xénomorphe! Si Rencontre du troisième type, E.T., Starman ou même La Soupe aux Choux avaient entre temps cherché à inverser la tendance malveillante du film de Ridley Scott, le cinéma engendrait régulièrement des œuvres sombres (The Thing, Lifeforce…), et moins d’un an après Aliens, le retour, l’espace prouvait encore une fois, à travers Predator, que l’inconnu et l’étranger inspirent avant tout la peur. Une peur à mille lieues de celle des années 1950, où l’ennemi venu souvent de la planète rouge était représenté sous toutes les formes possibles pour avertir de la menace communiste.
Requiem
L’invasion de la Terre par un individu ou une multitude est comparable aux pages sombres de l’histoire humaine (le massacre des indiens d’Amérique au hasard) renvoyant au film de guerre ou au western. Dans Predator, la cavalerie n’est pas venue. La bataille laisse un champ de désolation, un enfer sur Terre. Le clairon final est triste. Dutch lève les yeux vers le ciel, comme pour s’assurer que l’ennemi n’est pas venu en nombre. Nul doute que cet éclaireur, venu foudroyer une poignée d’hommes, n’est que le premier d’une longue série… Pour l’adolescent de presque quatorze ans sorti indemne mais transformé de cette épreuve filmique inattendue, c’est le début d’une aventure nouvelle à la recherche d’œuvres aussi marquantes, aussi insolentes. Car c’est bien d’insolence qu’il s’agit lorsque le spectacle promis, ou attendu selon, devient tout autre sur l’écran, c’est bien de l’insolence que de transformer un film d’action hollywoodien en une véritable leçon de cinéma ! C’est surtout très rare… Désormais, ce nouveau cinéphile n’aura de cesse que dénicher dans le passé et l’avenir des films complexes à la croisée de plusieurs genres, sublimés par la personnalité de véritables visionnaires. Du plomb parfois transformé en or selon la maîtrise de l’alchimie entre Joel Silver et son réalisateur John McTiernan. Dans cette quête initiatique qui débutait, c’est à peine un an plus tard qu’une nouvelle pépite naîtra de ce duo parti pour durer. Une pépite cristalline où un certain John McClane passera un Noël plutôt… mouvementé. Schwarzenegger ira s’adonner pour la première fois à la comédie (Jumeaux) avec succès. L’univers de Predator, lui, s’étendra dès 1991, pour le meilleur puis le pire…